Consommation
(1er novembre 2012)
La finance solidaire à un
tournant
 |
| © Marc Detiffe |
|
>>
Lire aussi |
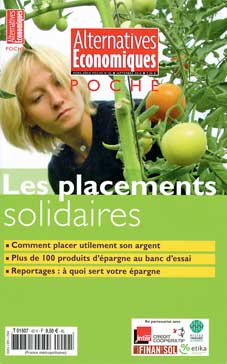 “Les
placements solidaires” • éd. Alternatives économiques, hors
série n°45 • sept. 2010 • (guide des
placements éthiques et solidaires). “Les
placements solidaires” • éd. Alternatives économiques, hors
série n°45 • sept. 2010 • (guide des
placements éthiques et solidaires).
“25 ans de
finance. La saga responsable et
irresponsable” • Financité, n°27, sept.
2012.
“Crise financière et modèle bancaires” • éd. Réseau financement
alternatif, oct. 2012.
>> Voir
www.financite.be
|
La notion
de finance solidaire n'est pas toute jeune, ni ses mises en pratique,
d'ailleurs. Encore marginale dans le paysage bancaire aujourd’hui, elle
répond toutefois aux préoccupations bien actuelles de “changer la finance”.
Au XIXe siècle déjà, des
banques populaires, des caisses solidaires et des sociétés coopératives
d'épargne lançaient le mouvement de la finance solidaire. Mais la dynamique
sera mise à mal par une orientation de la finance de plus en plus marquée
vers un modèle unique centré sur la banque commerciale. La privatisation du
secteur donnera largement le ton.
Ainsi peut-on lire la trajectoire du
Groupe Arco. Le démantèlement de Dexia induit par la non-maîtrise de la crise
de la dette souveraine européenne a concouru à la liquidation des sociétés
coopératives du Groupe. Cette liquidation récente plonge ses coopérateurs
francophones et flamands, ainsi que l'ensemble du Mouvement ouvrier chrétien
dans une attente pénible. Qu’en sera-t-il du remboursement de leurs
épargnes? Qu'en sera-t-il de la garantie d'Etat sur leurs parts? “Depuis les
années trente, le Groupe Arco (à l’époque la FNCC) était l’actionnaire de
référence de la caisse d’épargne coopérative COB, devenue par la suite la
Bacob. Cet actionnariat à la Bacob et aux Assurances populaires visait à
répondre aux besoins et aux attentes du monde ouvrier, rappelle Thierry
Jacques, actuel président du MOC. A la fin des années nonante, époque de
l’internationalisation des banques, l'opinion largement répandue était que
la Bacob ne pouvait continuer à ‘vivre’ seule. Les responsables de la banque
de l'époque ont opté pour l'acquisition de Paribas Belgique puis ont réalisé
sa fusion avec Bacob par la création d’Artesia. Les difficultés d’Artesia
ont ensuite contraint la banque à conduire une fusion avec Dexia, leader du
financement aux collectivités locales et dont les complémentarités de métier
et la proximité d’engagement social avec Artesia/ Bacob étaient
importantes.”
On connaît la suite : les fusions-acquisitions ont appauvri la
diversité du paysage bancaire (au fur et à mesure, on dira adieu à la CGER,
à la Bacob, à la Codep, au Crédit communal…), banque d'affaires et banques
d'épargne formeront des mariages contre-nature, la finance plongera dans le
monde de plus en plus opaque de la spéculation, des prises de risques...
Aujourd'hui, crise oblige, les remises en question ne manquent pas. Elles
vont en profondeur. Ainsi, l'ancien ministre des Finances, Philippe Maystadt,
reconnaît la nécessité d'une refondation de la finance, davantage au service
de l'intérêt général, ainsi que l'importance d'étendre une approche
alternative. En effet, quelques initiatives financières discordantes,
développées à petite échelle au cours des trente dernières années, montrent
qu'une autre voie est possible.
Depuis la “Banque-Apartheid”
Au départ de
ces alternatives, on trouve entre autres le refus de placer des liquidités
dans des banques qui effectuaient des opérations bancaires avec des régimes
minoritaires blancs d'Afrique australe. Nous sommes dans les années 70. On
parle du mouvement “Banque- Apartheid”. Le Conseil œcuménique des églises
est à l'origine du mouvement. L'impact des investissements interroge. Plus
tard, naissent des initiatives citoyennes d'épargne et de prêt de proximité
– des structures comme Crédal (1984) et le Réseau financement alternatif
(1987) voient le jour(1); tandis que certaines banques s'adaptent en
développant des produits financiers “socialement responsables” (voir encadré
ci-dessous).
Etat des lieux
Aujourd'hui, en Europe, il existe 30 à 35
institutions financières éthiques (une seule en Belgique, sous le nom de
Triodos). Ensemble, elles recueillent environ 35 milliards d'euros. “Une
goutte d'eau dans l'océan bancaire”, fait remarquer le Réseau financement
alternatif (RFA) dans un dossier consacré à 25 ans de finance solidaire
publié dans sa revue Financité. “Si la qualité des banques éthiques est à
souligner, si celles-ci ont mieux résisté à la crise, force est de constater
que leur influence reste marginale”, y écrit Antoine Attout, chargé de la
formation citoyenne pour le Réseau.
Quant à l'investissement socialement
responsable (ISR), il est traduit dans pas moins de 1.089 produits
financiers dont 340 fonds de placement et 7 comptes épargne. Mais il ne
représente que 3,4% de parts de marché. “Ce n'est pas grand chose, et en
même temps la progression est substantielle (une croissance de 9% en 2011).
L'intérêt se confirme”, commente Bernard Bayot, directeur du Réseau
financement alternatif qui a participé à la création du premier produit
bancaire ISR: le compte épargne Cigale de la feue CGER, en 1984. “La
Belgique n'a pas à rougir dans ce domaine, poursuit-il, même si dans
d'autres pays comme la France, le montant en investissements solidaires est
plus élevé, grâce notamment à des avantages fiscaux accordés pour ce type
d'investissement”.
Poursuivre la voie du solidaire
Depuis une trentaine
d'années, le développement d'une finance qualifiée de “responsable et
solidaire” n'est pas négligeable. Pourtant, “elle n'a été d'aucun secours
dans la catastrophe”, invite à reconnaître Bernard Bayot. “Ni
quantitativement, car de beaucoup trop petite taille pour avoir une quelque
influence. Ni qualitativement, car la contagion culturelle que d'aucuns
espéraient n'a manifestement pas atteint les quartiers généraux des grandes
banques”. Raisons de plus pour ces acteurs, comme le Réseau financement
alternatif et ses membres, de poursuivre dans la volonté de “changer la
finance”.
Développer l'offre fait partie des passages obligés pour cultiver
le “bien-avoir” comme l'appelle Fabio Salviato, président de la Fédération
européenne des banques éthiques et alternatives. Une nouvelle banque
coopérative sous le nom de travail : NewB est en gestation, sous l'impulsion
d'une petite cinquantaine d'organisations dont l'organisation syndicale CNE.
//
CATHERINE DALOZE
(1) Crédal, créé à
l'initiative de Justice et Paix et Vivre ensemble est une coopérative de
crédit alternatif qui compte plus de 1.800 investisseurs-coopérateurs. Elle
finance des associations et entreprise d'économie sociale, des personnes
exclues bancaires pour des microcrédits professionnel ou personnel. Le
Réseau financement alternatif regroupe 90 associations et institutions, dans
la perspective de “Ensemble, changer la finance”. Ses axes de travail :
comprendre, partager, innover, mobiliser.
Initiatives à l'échelle du citoyen
De plus en plus de
citoyens s'interrogent sur les “dérives” de la finance. Le Réseau
financement alternatif le constate très clairement. Si les activités qu'il
organisait en soirée voici 7 ou 8 ans regroupaient quelques curieux,
aujourd'hui le Réseau est débordé de demandes citoyennes. Une trentaine de
groupes locaux atteste de ce regain d'intérêt et témoigne de la conviction
grandissante que “l'on peut penser le type de finance que l'on pratique”.
“Nous avons pratiquement tous un compte à la banque ou quelques économies
qui y sont placées mais nous ignorons dans quelles activités la banque place
nos économies, constate le Réseau. Les bénéfices qu'elle en tire sont
réinjectés dans un système financier qui échappe à la plupart d'entre nous.
Il est en effet très difficile de savoir aujourd’hui ce que financent les
banques”. Les groupes locaux “Financité” – soutenus par le Réseau – sont
formés de personnes que le sujet interpelle et qui décident d'actions
communes autour d'au moins un des trois thèmes suivants : “Que faire de mon
épargne? Vivre à crédit? Ou utiliser une monnaie locale?”
En résulte une
grande diversité d'initiatives. Certains qui ont un peu de réserves
financières et souhaitent choisir l'usage qui sera fait de cet argent, se
rassemblent en groupe d'épargne de proximité. Ils s'auto-organisent à dix,
vingt ou trente, gèrent ensemble leur épargne, choisissant les crédits
qu'ils octroient(souvent à des projets associatifs). Ils pratiquent une
forme d'auto-banque. Pas besoin d'être richissime pour cela. Dans le groupe
local Ethique Invest à Bruxelles, c'est 500 euros que ces “investisseurs
alternatifs” ont versé chacun pour expérimenter une autre manière
d'investir. La vertu est surtout pédagogique, expliquent les protagonistes
qui s'attellent ensemble à comprendre les mécanismes de la finance.
L'objectif n'est pas la plus-value financière, mais bien la plus-value
sociale.
D'autres groupes, comme à Mons ou à Virton, sont avant tout attirés
par la “relocalisation”. Pour redimensionner les échanges au niveau local,
ils mettent en place un système de monnaie complémentaire ou un SEL (système
d'échange local). Les échanges de biens et de services sont mesurés au
travers d'une autre unité d’échange que l’euro. Le temps, par exemple.
Et
enfin, parce qu'épargner n'est pas qu'une affaire de riche, des groupes de
micro-épargne encouragent les personnes à revenus modestes à épargner.
Plutôt qu’à consommer à crédit, que de contracter des crédits inadéquats qui
mènent beaucoup au surendettement, ces groupes s'attelle à davantage
anticiper, à retrouver prise sur leurs finances, à gérer un budget.
>> Plus
d'infos : Réseau financement alternatif :
www.financite.be • 02/340.08.60
|
Derrière l'investissement socialement responsable
|
|
L'investissement socialement responsable (ISR) se définit comme toute forme
d’investissement (au travers d'une épargne ou d'un actionnariat) qui intègre
d'autres critères qu'uniquement financiers : des préoccupations sociales,
éthiques, environnementales. L'évolution quantitative des ISR apparaît
plutôt favorable (lire ci-dessus) mais leur qualité est très variable,
remarque Bernard Bayot du Réseau financement alternatif.
Si le dernier
rapport sur l'ISR en Belgique augmente sa note qualitative moyenne (de
5,8/100 en 2010 à 6,4/100 en 2011), elle reste bien modeste. 73% des
produits ont obtenu zéro. Nombre d'ISR cachent-ils de belles promesses de
financiers dans le but de se doter d'une image éthiquement responsable
auprès des clients? Le Réseau financement alternatif préconise en tout cas
la mise en œuvre d'une norme de qualité légale. Une proposition de loi est
déposée au Sénat en ce sens. Mais la crise semble avoir mis entre
parenthèses les réflexions politiques autour de cette forme de
“labellisation” qui permettrait, espère Bernard Bayot, de réserver des
avantages fiscaux (stimulants fiscaux) à des produits pour les particuliers
respectant ces critères. Et de citer une épargne pension dirigée vers le
socialement responsable. |
|

